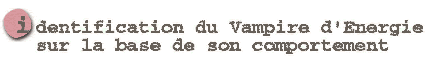 |


Le déni de la dignité humaine par le Vampire
Nous avons déjà dit un mot du moyen d’appropriation d’énergie qu’est la privation de dignité, faisant référence à la courte nouvelle Le gérant: la rencontre du Vampire, et des moyens rustres par lesquels il s’approprie l’énergie vitale contenue dans la dignité humaine, y débouche sur un sentiment d’inadaptation face à la vie, et sur la sensation de se trouver à un carrefour: ou l’on se résigne à sa propre infériorité, ou l’on bifurque et se comporte comme le Vampire. C’est ce qui arrive à Massimo, le protagoniste, à la suite de la scène qui a été décrite à propos des symptômes d’agression vampirique. Humilié par les deux personnages qui s’obstinent à ne pas répondre à son salut, Massimo devient la proie d’une étrange et énigmatique vision de la condition à laquelle les Vampires réduisent leurs victimes.
Alors qu’il actionnait la poignée de la porte cochère, il eut le sentiment d’avoir rejoint, malgré lui, les rangs d’un régiment. Une légion d’individus qui n’avaient plus le choix. Ils étaient vêtus en forçats et portaient, pendus à leur cou, un panneau qui disait: ATTENTION: INDIVIDU PRIVE DE DIGNITE. LES PLUS ELEMENTAIRES REGLES DE POLITESSE ENVERS CET INDIVIDU SONT SUSPENDUES JUSQU’A NOUVEL ORDRE. Dans le reflet de la porte vitrée, il se vit, parmi de nombreux autres forçats, faire la queue pour atteindre une table où un employé distribuait à chacun une feuille grise; quand ce fut son tour, on lui présenta un crayon à papier: il devait tracer une croix dans une des cases que proposait la feuille grise; sur la première était écrit: HUMILIATION; sur la seconde: SUPERIORITE. Massimo hésita. Il pouvait choisir entre accepter avec soumission ce qui s’était produit, ou réagir avec supériorité, concluant: "Mais tu sais ce qu’il m’importe à moi, le salut de ces deux péquenots!". Etant entendu que quel que soit son choix, il serait entré dans une logique aliénée où les hommes ne sont pas égaux: ou quelqu’un se sent supérieur à un autre et cet autre l’accepte, ou bien tous deux se sentent supérieurs et se méprisent l’un l’autre. Tracer une petite croix dans n’importe quelle des cases de cette feuille grise signifiait, de quelque façon, commettre un crime contre l’humanité, et contre l’unique, l’incontestable vérité, religieuse et laïque, qui existe sur terre, selon laquelle les hommes sont tous égaux.
Le schème réapparaît ailleurs, en particulier dans la nouvelle déjà citée de La 1100 Belvedere. Il s’agit d’une nouvelle fantastique dans laquelle le protagoniste, lors d’un voyage en voiture avec Chicca, sa petite fille de trois ans, et grâce au prodige d’un mystérieux décalage temporel, se retrouve face à lui enfant, et à son père à l’âge qu’il a, lui, au moment de l’histoire. Les événements survenus dans l’enfance du protagoniste sont au centre de la nouvelle. Un enfant (comme nous l’avons déjà évoqué dans la partie consacrée aux symptômes d’agression vampirique) considéré ‘coupable’ d’avoir découvert un secret de famille qu’il ne devait pas découvrir, et pour cette raison, brusquement privé de la dignité dont il pouvait jouir auparavant, et confiné dans une dimension d’‘étrangeté’ et de discrédit permanent. Le tout, évidemment, dans le but de dénigrer ses affirmations. Dans cette conjuration vampirique à l’encontre d’un innocent, le père a un rôle marginal; toutefois il devient le complice idéal des véritables persécuteurs d’enfants, sa femme et un ‘ami de famille’ ambigu: en effet, tout en suspectant la vérité, il préfère ne pas la voir, jusqu’à en venir à la décision de confier son fils, sur exhortation de sa femme, au soin du docteur Maggi, c’est-à-dire tout bonnement à celui qui est au centre de l’inavouable secret de famille. Voici la description que le père fait de l’enfant:
"Il est bizarre. Tellement bizarre. Avant, c’était un enfant
toujours gai, jovial, plein de fantaisie. Il chantait et récitait des
poésies pour tout le monde. Il inventait des histoires. Intelligent.
Eveillé. Mais maintenant, au contraire [...] Le voilà. Toujours en train
de bouder. Il est devenu revêche et distant, lui qui était solaire,
ouvert et affable avec les étrangers. Pensez un peu que quand je l’emmenais
au travail avec moi, il y a encore peu, il était l’attraction de tout
le bureau. Tout le monde l’adorait. Maintenant ils le traitent comme s’il
avait quelque maladie. Il reste là dans un coin, silencieux, il répond
à peine au salut de mes collègues, il ne sourit même pas par obligeance.
Et puis à la maison il est devenu arrogant. Et déloyal. On dirait qu’il
est toujours en train de ruminer quelque chose. Il ne parle jamais, et
dès qu’il s’agit de lui faire un reproche, il monte sur ses grands
chevaux. Dans ces moments, un peu qu’il parle. Il n’y a que les coups
qui le fassent taire. Il trouve à redire et chipote pour n’importe quoi.
Je vous assure que tenter de le faire céder, dans ces conditions, c’est
la croix et la bannière. On a même pensé un moment le confier à
quelque... établissement religieux, où ils sachent lui parler, le guider.
Mais je n’ai vraiment pas le cœur. Je préférerais que le docteur
Maggi lui donne un traitement, me conseille quelque thérapie, quelque
entretien avec un psychologue, je ne sais pas, je ne sais pas..."
"Vous semblez accorder une grande confiance au docteur Maggi."
"C’est une personne d’expérience. Un ami de confiance.
Quelqu’un qui connaît bien nos problèmes de famille. Et puis mon
épouse, pauvre femme, elle n’en peut vraiment plus."
Voici au contraire la vision qu’a le protagoniste de l’enfant, affranchi, grâce au prodige d’une telle rencontre, de l’emprise des versions ‘officielles’ commodes, et libre d’aimer ce petit garçon qu’il est, et de s’accepter:
La bouche qui avait peut-être trop parlé, trop exprimé, et qui maintenant s’était figée dans la fixité exsangue d’une fente perpétuellement refermée à demi. Un nez dont le développement hésitait entre un retroussement qui l’aurait livré à l’éternel enfantin et finalement, au ridicule, et un allongement qui aurait signé son visage, avant l’âge, de la marque de sa condition déjà trop adulte. Le visage allongé. La tête qui, il y a encore quelques mois, avait du être arrondie et bien proportionnée, s’étirait désormais un peu trop en pointe vers le ciel, à la recherche d’une réponse, d’une voix d’ange qui l’aide à comprendre un pourquoi trop difficile pour son âme d’enfant. Les oreilles largement décollées, comme à vouloir écouter à la porte d’une vie qui lui avait fait la promesse de mélodies extraordinaires et qui maintenant l’avait exclu des délices de son beau chant. Et enfin les yeux, voilés comme deux étoiles qui brillent au loin et ont pour toile de fond une forêt de cheminées d’usine insensibles au ciel et seulement capables de l’enfumer de leurs lourdes scories.
Voici enfin les réflexions avec lesquelles le protagoniste clôt le réexamen de cet âge où la dignité d’un innocent avait été sacrifiée à une exigence supérieure, et l’audacieuse décision qui s’ensuit:
Je pensai à mon père, qui était enfermé dans l’obscurité de sa 1100 Belvedere, et mon cœur se serra. C’était un brave homme, qui comme chacun de nous, sait sans savoir et se pose des questions sans réponse, juste parce qu’elles lui donnent la possibilité de s’agripper au doute; et il sait bien que s’il cessait un moment de se poser ces questions aveugles, il devrait se confronter aux réponses qui depuis toujours étaient là, tout simplement là. Mais je pensai aussi "aux problèmes de famille", à ma mère qui n’en pouvait plus, à Maggi, à combien il était un homme "d’expérience", et "de confiance", aux traitements et aux thérapies qu’on organisait pour immerger dans les fonds baptismaux de l’oubli cet enfant, qui un jour avait été heureux, mais qui désormais en savait trop pour pouvoir l’être encore. Je rentrai précipitamment et claquai la porte de la voiture, comme un policier américain qui s’apprête à poursuivre un criminel. J’attachai Chicca à son petit siège, je mis ma ceinture de façon décidée et verrouillai les portes. Puis, je le regardai dans le rétroviseur: ses gros yeux brillaient, et il avait la même figure excitée et extasiée que quand papa n’avait pas encore rencontré Maggi, et qu’il le faisait rêver parce que c’était un grand héros. Je passai la première vitesse et partis.
Dans la nouvelle Angelo, Ivan, comme nous le savons, est un footballeur de talent dont les ennuis commencent quand Angelo, le capitaine de l’équipe, entre en compétition avec lui. Voici comment les yeux de Angelo réussissent à distordre de façon grotesque la figure de Ivan, lequel à l’inverse ne nourrit aucun sentiment de compétition envers Angelo.
Angelo était stressé et frustré comme cela ne lui était jamais arrivé dans sa vie. Son univers avait volé en éclats après l’arrivée d’Ivan. L’idole, le mythe, le capitaine et le chef indiscuté de l’équipe et du quartier, c’était encore lui, mais ce petit-maître, qui ne savait envoyer dans les buts que des balles aérées qui étaient déjà destinées à y finir, était arrivé dans sa vie comme une malédiction. Il le haïssait déjà. Il le haïssait pour sa fausse modestie, pour sa fausse générosité, parce qu’il lui plaçait toujours cette balle juste dans les pieds, jamais quelques mètres en avant comme lui le voulait, et il le faisait exprès, pour le faire trébucher. Il le haïssait parce que c’était un fils à papa, parce qu’il allait à l’université au lieu de gagner sa vie en peinant, comme lui. Parce qu’avare de toute parole élogieuse, ou même de considération à son égard, il se limitait à lui sourire avec sa face de crétin, comme s’il voulait lui faire comprendre que pour lui le grand Angelo n’était personne. Il le détestait parce qu’il avait une chance absurde. Il tirait dans les buts et la balle entrait dedans, tantôt en roulant, tantôt en rebondissant, tantôt échappant au portier et tantôt directement, mais toujours mal tirée, avec ce pied qui avait l’air d’une pioche. Il le détestait parce qu’Ivan était un privilégié, un hypocrite, un chi-chi...
Dans le langage d’Angelo, l’expression chi-chi est la pire des insultes que l’on puisse adresser à un homme. Chi-chi veut en effet dire chic et indique tout ce que l’on peut concevoir de plus sophistiqué, léché, privilégié et efféminé. La réaction d’Angelo sera mortifère et consistera à nier à Ivan sa dignité humaine, justement en faisant jouer le concept de chi-chi, qui suffira par lui-même à déchaîner contre Ivan la haine de tout le quartier.
Ivan fut continuellement contesté, sifflé et hué pendant les matchs; une fois, alors qu’ils lui hurlaient "piazza-le-lo-re-to piazza-le-lo-re-to1", il s’arrêta pour discuter avec le public et chercha à expliquer qu’entre lui et son rival, on ne saurait dire qui était le plus prolétaire, parce que lui était fils d’un syndicaliste de la CGIL et Angelo d’un entrepreneur; Mais une bouteille de chinotto vide lui atterrit sur la tête et il finit aux urgences. La carrosserie de sa Seicento fut rayée, les pneus crevés, le pare-brise fêlé et les essuie-glaces cassés.
Ivan, privé, par le déni de sa dignité, de toute son énergie vitale, et incapable de réagir adéquatement à l’anathème social dont l’a frappé Angelo, entrera dans une crise personnelle qui non seulement le poussera à abandonner le football, mais qui aura de graves répercussions autant sur sa vie affective que sur ses études.
Le thème du déni de dignité intervient également, de façon dramatique, dans la nouvelle Le masque. Une mère-fantôme qui, alors en vie, avait senti sa relation avec sa fille menacée par l’existence du mari de cette dernière, est prisonnière d’une dimension crépusculaire dans laquelle, n’arrivant pas à réaliser sa condition de trépassée, elle continue à tourmenter sa fille, exactement comme elle le faisait vivante. Le moyen mis en œuvre pour se défendre, morte ou vive, de cette menace est évidemment de discréditer le gendre aux yeux de la fille, déniant toute dignité à sa qualité d’humain. Le mari est encore une fois Massimo, le protagoniste de Samuel Serrandi et de Le gérant, qui, selon une habitude des nouvelles de Mario Corte, passe d’une nouvelle à l’autre.
La mère ouvrit le frigidaire et prit la petite casserole avec le
potage et le plat en terre cuite où se trouvaient deux quarts de poulet.
Ale crut se souvenir qu’Aurora avait cassé ce plat des mois auparavant.
La casserole non plus, elle ne l’avait pas vue depuis très longtemps.
La sonnerie stridente de l’interphone couvrit le bruit du poulet en
train de mijoter que la mère avait mis à chauffer dans le plat en terre
cuite. C’était Massimo. Il voulait savoir s’il devait aller acheter
du lait pour Aurora. Ale traversa la cuisine vide et silencieuse, et alors
qu’elle s’apprêtait à ouvrir le réfrigérateur, elle se rappela
avoir déjà acheté un litre de lait en faisant les courses le matin.
Elle revint vers le combiné de l’interphone pour dire à Massimo qu’il
n’y avait pas besoin de lait, mais en se tournant elle vit la main de sa
mère posée sur un angle de la table, illuminée par la lumière du
soleil désormais mourant; le reste de la silhouette était immergé dans
l’obscurité. Alors, elle décida qu’un autre litre de lait n’aurait
peut-être pas été de trop, et envoya Massimo l’acheter. De retour
dans la cuisine, elle vit le quart de poulet fumant dans son assiette et
sa mère qui se débattait avec les ordures.
"Pourquoi jettes-tu l’autre poulet, maman?"
"Parce que la cuisse me fait du mal: c’est trop gras "
"Si tu me l’avais dit avant, c’est moi qui l’aurais mangée et
je t’aurais donné le blanc."
"Tu n’as toujours aimé que le blanc."
"Et alors, qu’est-ce que tu vas manger à part le potage?"
"Rien."
"Maman..."
"Dépêchons-nous, il va arriver d’une minute à l’autre."
"Pourquoi, tu ne veux pas le voir?"
"C’est lui qui ne souhaite pas me voir."
"Après tout ce temps, Massimo ne te plaît toujours pas, pas vrai?"
"C’est tout de même pas à moi qu’il est censé plaire."
"Pourtant à moi, ça me ferait plaisir que la personne qui vit à
mes côtés te plaise."
"A moi aussi ça me ferait plaisir."
"Et pourquoi ne te plaît-il pas?"
"Il n’est pas sincère."
"Qu’est-ce que tu en sais?"
"Ça se voit. On a l’impression qu’il cherche toujours à se
cacher."
"C’est peut-être par timidité."
"Ce n’est pas par timidité. Moi, je suis timide. Je connais
la timidité."
"Et qu’est-ce que c’est?"
"De la fausseté."
"Comment peux-tu en être aussi sûre?"
"Je le sais."
"Il ne se pourrait pas que tu te trompes?"
"Non."
"Qu’est-ce qui te fait penser que tu as toujours raison?"
"Je n’ai pas toujours raison. Mais sur cette question, j’ai
raison."
"Et comment le sais-tu?"
"Je le sais."
"Pourquoi ne l’as-tu jamais aimé, maman?", dit Ale d’une
voix tremblante.
"Parce que c’est un tiède. Un peureux. Un mort. Et toi tu
ne..."
[...] "Ce n’est pas vrai, maman. Il est vivant. Et Aurora aussi est
vivante. Et moi aussi..."
"Toi, tu es comme moi, pas comme lui."
1"Place Loreto", place de Milan où le cadavre de Mussolini, à la fin de la seconde guerre mondiale, fut exposé aux injures de la foule. Dans la nouvelle, les huées du public reviennent donc à traiter Ivan de fasciste en lui souhaitant la même fin.
![]() HOME -
HOME - ![]() DEBUT
DE SECTION -
DEBUT
DE SECTION - ![]() PAGE
SUIVANTE
PAGE
SUIVANTE
Copyright ©2001 Mario Corte